Le point de départ de mon roman était la restitution d’une statuette sacrée en Afrique. Mais quelle statuette ? Dans mon récit, il s’agit d’un artefact fictif, inventé pour les besoins de l’histoire. Pourtant, je me suis inspirée d’un objet bien réel : une statuette qui trônait dans l’appartement de mon enfance. Elle était posée dans une niche qui semblait faite pour elle. Étrangement, c’était aussi l’un des lieux préférés de nos chats, qui aimaient s’y lover. Cette statuette, un eyema-byeri, était utilisée dans les cérémonies initiatiques des tribus Fang, notamment au Gabon.

Rapportée d’Afrique par mes grands-parents, elle a fini par être vendue aux enchères, bien avant que je n’aie entendu parler de restitution d’œuvres sacrées. À l’époque, cela ne m’avait pas choquée ; j’avais seulement regretté de ne plus la voir. Ce n’est qu’en écrivant La restitution que j’ai compris tout ce que cet objet représentait.
Je me suis souvent demandé comment mes grands-parents l’avaient acquise et ce qu’ils savaient vraiment du byeri. Ont-ils, malgré eux, participé à la disparition de ce culte en imposant le christianisme ?
Image générée par ChatGPT, à partir de photos
La vision d’alors n’était pas celle d’aujourd’hui. Mais à travers leurs écrits, je sais qu’ils respectaient profondément les Africains qu’ils avaient rencontrés — certains sont d’ailleurs restés des amis fidèles, venus plus tard leur rendre visite en Suisse.
Le byeri
Le byeri désigne à la fois un culte dédié aux ancêtres et les objets rituels qui lui sont associés. Cœur de la vie spirituelle des Fang, ce culte initiatique et masculin était gardé secret. Les sculptures étaient posées sur des boîtes en écorce contenant les crânes et ossements des ancêtres les plus vénérés. Ces reliquaires, “nourris” d’huiles, de sang et de poudre rouge, symbolisaient le lien entre vivants et morts.
Les Fang consultaient leurs ancêtres pour toutes les décisions majeures : chasse, guerre, voyage, maladie. La communication s’opérait par les rêves, parfois sous l’effet d’une plante hallucinogène, l’alan (Alchornea floribunda).
Au XIXᵉ siècle, ce culte a rencontré le Bwiti, introduit par d’autres peuples et fondé sur l’usage de l’iboga. Le Byeri et le Bwiti se sont alors mêlés, intégrant même des éléments chrétiens.
Interdit par les colons et les missionnaires, le byeri a survécu dans la clandestinité. Aujourd’hui encore, il existerait sous des formes simplifiées, toujours centrées sur le dialogue entre les vivants et leurs ancêtres.
Pour en savoir plus, je vous recommande l’article passionnant de Giorgio Samorini, La plante alan et le culte des ancêtres chez les Fang du Gabon, publié dans le Antrocom Journal of Anthropology.
Sources : https://musees.marseille.fr/statue-de-reliquaire-byeri
https://collection-lacharriere.quaibranly.fr/img/1ac/28-gardien-de-reliquaire-eyema-byeri.pdf
https://savoirfairekang.com/la-societe-secrete-byeri-et-le-culte-des-ancetres/
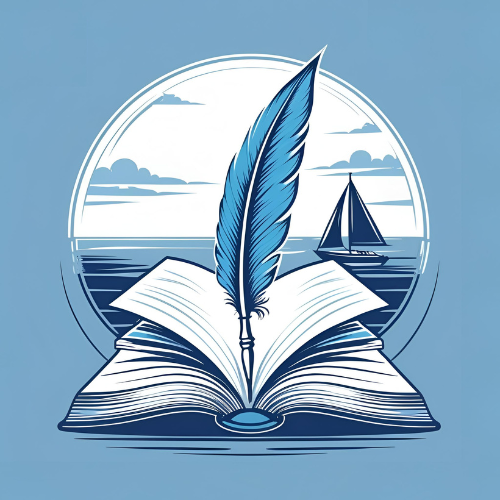
Laisser un commentaire